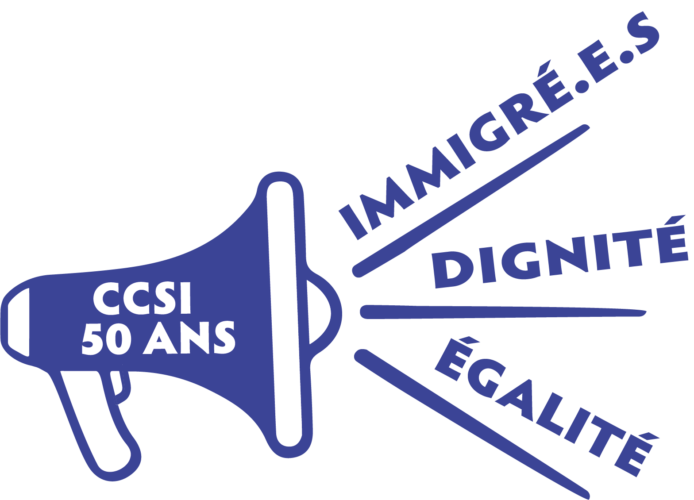CCSI-Info janvier 2025
Pour télécharger ce numéro au format PDF, cliquez ici
Éditorial
Il y a 50 ans, sous l’impulsion décisive du Centre social protestant et avec les grandes associations d’immigré.e.s de l’époque, était fondé à Genève un «Centre de contact», structure qui deviendrait l’année suivante le «CCSI» en vertu de ses premiers statuts adoptés en septembre 1975.
Pour comprendre la portée d’une telle création, il faut se replacer dans le climat d’alors. A propos de la Suisse des années soixante, le sociologue tessinois Sergio Agustoni évoque deux réalités parallèles, qui coexistent mais dont les vies se croisent rarement: «La première Suisse est peuplée par les Helvètes, dont les maisons commencent à se remplir des premiers biens matériels – frigo, télé, voiture – grâce à l’essor économique. Dans la société helvétique en pleine mutation des espaces d’ascension sociale s’ouvrent même aux familles modestes. L’autre Suisse, en revanche, est peuplée de travailleurs étrangers: leur vie est faite de baraques, d’interdiction de changer d’employeur et de travail et, dans le cas des travailleurs saisonniers, de famille divisée par la loi».
L’affrontement entre les deux Suisses atteint son paroxysme avec le vote sur l’initiative Schwarzenbach de 1970. Bien que rejetée de justesse, cette initiative polarise la population et laissera des traces importantes, ravivées par une nouvelle initiative xénophobe soumise à votation en 1974. C’est dans ce contexte, rendu encore plus incandescent par la récession économique due à la crise pétrolière, que naît le «Centre de contact», qui va constituer un pont entre deux mondes jusque-là séparés. Le projet n’est pas celui, paternaliste, d’un «centre pour les immigrés» mais plutôt celui d’une structure nouvelle qui fédère toutes les forces engagées en faveur d’une politique suisse plus humaine à l’égard des immigré.es.
Depuis lors, et par-delà les changements de structure organisationnelle, un même fil rouge guide le travail mené par le CCSI : la fidélité aux valeurs d’humanité et d’égalité pour les travailleuses et travailleurs étranger.e.s et leurs familles. A l’image par exemple de sa mobilisation pour le regroupement familial, le droit à la scolarisation des enfants sans statut légal ou la régularisation des sans-papiers au travers du projet pilote « Papyrus ». Ces jalons ne sont pas seulement l’histoire du CCSI. Ils inspirent aujourd’hui encore l’engagement de notre association pour concrétiser et maintenir les droits acquis, et œuvrer à leur exte______–nsion.
A l’heure de marquer notre jubilé – et alors que l’atmosphère politique est toujours plus stigmatisante à l’égard des étrangers –, il nous semble plus important que jamais de rappeler la contribution indéniable des immigré.e.s à l’histoire politique, économique et sociale de la Suisse, et de porter haut et fort la voix de nos usagers et usagères, qui sont au cœur de notre action. Les pages qui suivent et les événements prévus en mai prochain s’inscrivent dans ce cadre et susciteront, nous l’espérons, votre intérêt.
A la rencontre de nos usager.e.s (I)
Dans cette série initiée à l’occasion de nos 50 ans, des jeunes adultes nous racontent leur parcours de vie à Genève, des années passées sans papiers à leur existence d’aujourd’hui – libre, indépendante et pleine de projets -, que l’obtention d’un permis a rendue possible.
Lorsque je rencontre Maria un après-midi d’octobre 2024, elle vient d’avoir 30 ans. En complément à son emploi de secrétaire dans une association, elle travaille comme interprète communautaire à la Croix-Rouge genevoise. Cette jeune femme d’origine bolivienne a répondu avec enthousiasme à notre invitation et va me raconter son histoire sans jamais perdre son sourire, même à l’évocation de certains épisodes difficiles de sa vie.
Arrivée en Suisse à l’âge de 10 ans, Maria se souvient bien de ses premières impressions et expériences à Genève, où elle retrouve ses parents qu’elle n’a pas vus depuis deux ans. « Je suis arrivée fin janvier 2005, il neigeait… et j’ai vu les grandes montagnes au loin, j’étais émerveillée. Papa m’avait inscrite à l’école primaire des Grottes et là tout était nouveau pour moi: la salle de classe avec une grande fenêtre, mon propre pupitre, le coin lecture et jeux et tous ces camarades de cultures différentes. Dans ma classe, il y avait deux filles d’origine colombienne et espagnole. Ce sont elles qui m’ont servi d’interprètes. C’était beau mais un peu effrayant aussi, car je ne parlais pas la langue et ne savais pas comment me comporter. Et puis les élèves tutoyaient la maîtresse, ce qui était déstabilisant pour moi, car en Bolivie on disait vous aux instituteurs».
Maria se familiarise peu à peu avec son nouvel environnement, découvre des matières comme l’allemand et la géographie suisse, mais bientôt elle éprouve de la frustration et le sentiment de ne pas être à la hauteur face aux difficultés d’apprentissage dues à la langue. L’été qui précède la rentrée au Cycle est difficile. « J’étais triste à cette époque, car mon frère et mes sœurs restés en Bolivie me manquaient. Et puis j’étais en surpoids et je me sentais jugée à cause de mon physique. Je voulais rentrer en Bolivie. Mais ma mère n’était pas d’accord. Elle disait qu’elle avait fait beaucoup d’efforts pour me faire venir ici…. Alors le jour de la rentrée, je ne suis pas allée en classe. Maman a été informée et on a été convoquées par la doyenne, à qui j’ai expliqué que j’avais honte de mon physique et que je ne me sentais pas intelligente. Cette dame m’a écoutée et encouragée. Elle m’a expliqué que je n’étais pas la seule à ressentir cela et que c’était normal à l’âge de l’adolescence. Alors j’ai accepté d’aller en classe, et au final je me suis fait des amis au cours de ces trois ans ».
En 2007, le frère et les sœurs de Maria arrivent à Genève. La famille est heureuse d’être réunie mais la vie à 6 dans un studio de l’Armée du Salut n’est pas facile. « Mais comme on était sans-papiers on n’avait pas la possibilité de trouver un autre logement. Alors un jour, mon frère et mes sœurs, qui ont toujours eu le mal du pays, ont fini par rentrer en Bolivie avec l’aide de la Croix-Rouge ». Maria, elle, choisit de rester avec ses parents. Sa mère travaille beaucoup, comme nounou et femme de ménage. Son père est jardinier le matin, et s’occupe d’elle les après-midis. Mais suite à leur séparation, Maria se retrouve seule avec sa mère, une vie à deux rythmée par de longs moments de solitude, qui pèsent à Maria. Une rencontre va toutefois changer les choses. «En 2010, j’ai connu une église où les cultes étaient en espagnol et je me suis réfugiée en Dieu. C’est là aussi que j’ai commencé à agir en tant qu’interprète, pour les fidèles non hispanophones. Grâce à cette expérience, j’ai eu le sentiment d’appartenir à une communauté et cela m’a beaucoup aidée».
Adolescente, Maria est consciente de la situation légale de sa famille. Elle entend ses parents parler de la difficulté d’obtenir un permis de séjour en Suisse. Elle sait que ce permis dépend d’un travail déclaré et de longues démarches. Elle sait aussi qu’ils risquent l’expulsion en cas de contrôle et fait toujours attention d’avoir son abonnement de bus sur elle. En grandissant, elle voit ce que ses amis possèdent et qu’elle ne peut avoir, comme une chambre à elle, ou un téléphone. Et puis il y a ce jour où, à l’ECG, «les profs annoncent le voyage d’études à Séville… je me suis inscrite toute contente ! Mais quand ils m’ont expliqué les documents que je devais fournir avant le départ, j’ai compris que je ne pourrais pas y participer. C’était très frustrant». Maria rêve aussi de faire un apprentissage d’employée de commerce, mais là encore ce n’est pas possible, et malgré sa nature positive, elle ressent un grand découragement face à tous ces obstacles.
Un jour de 2015, une amie leur parle du CCSI et les encourage à s’y rendre. Sa mère, qui a entre-temps trouvé un travail déclaré et cotise à l’AVS, décide de suivre ce conseil. «Au CCSI, Mme Eva nous a renseignées sur les démarches à faire pour obtenir un permis. Elle nous a dit qu’il faudrait réunir beaucoup de papiers et que rien n’était sûr. Mais ma mère a décidé de le faire, même si on n’avait pas trop d’espoir… Quand on a reçu l’avis positif de l’OCPM, on était tellement heureuses! Mais on savait qu’il fallait attendre la décision de Berne…. Alors on passait de l’espoir au doute. Mais ma mère a tout de suite demandé un visa pour aller voir mes frère et sœurs en Bolivie. Et enfin, le jour est venu où le CCSI nous a appelées pour qu’on vienne chercher notre permis ! » Nous sommes alors en 2017, Maria a 21 ans et son monde, soudain, s’ouvre devant elle.
« Nos deux noms sur la boîte-aux-lettres! »
Elle part pour la première fois en vacances à l’étranger, dans son pays d’origine. Même si elle sait que ses papiers sont en ordre, elle éprouve tout de même un peu de stress en passant la frontière… Après l’ECG, où elle a choisi l’option sociale, elle signe un contrat de travail et suit, en parallèle, une formation d’assistante administrative, pour laquelle elle obtient un certificat en 2021. Avec le permis, sa maman peut enfin contracter une assurance maladie, ce qui la rassure beaucoup après tant d’années à redouter de devoir se soigner. Et puis toutes les deux ont déposé une demande de logement à la Ville et au niveau cantonal. Et un jour de décembre, « maman a reçu un appel puis une lettre concernant un appartement de 3 pièces. On est allées le visiter, il était beau, alors bien sûr on l’a pris. Et on y est toujours ! Avec nos deux noms sur la porte et la boîte aux lettres… comme j’en avais tant rêvé ! ».
Aider les personnes sans-papiers
Aujourd’hui, Maria est heureuse et se « sent bien » ici. Elle qui depuis toute petite voulait aider et soigner les autres, a trouvé sa place au sein de la Croix-Rouge et auprès des sans-papiers qu’elle aide en tant qu’interprète. «Je comprends bien leur situation, car je l’ai vécue. Cela ravive beaucoup d’émotions. Et me rappelle tous les jours ce que j’ai ressenti au moment d’obtenir le permis : le sentiment d’être enfin une personne normale… d’exister dans la société… et de pouvoir faire valoir mes droits ».
Dans le futur, Maria souhaiterait que tous les enfants sans-papiers dans le monde aient droit à l’éducation, comme c’est le cas à Genève. Son papa lui avait dit, à son arrivée, que les enfants ici étaient protégés, et c’est ce qu’elle a toujours ressenti auprès de ses enseignants. Elle voudrait aussi que ce droit s’applique aux jeunes adultes qui souhaitent faire un apprentissage ou aller à l’université. Et puis elle espère qu’un jour l’accès à la santé sera garanti pour tous, y compris les adultes sans statut légal.
Brigitte Gremaud
Le CCSI, dans les mots de…
Membre de l’équipe du CCSI depuis plus de trois décennies, Catherine Lack a contribué à nombre d’actions et campagnes menées par l’association et/ou ses partenaires, et continue d’accompagner, avec cœur et conviction, les usager.e.s qu’elle reçoit dans sa consultation. A l’heure de célébrer nos 50 ans, Catherine a choisi quelques mots qui symbolisent à ses yeux la mission du CCSI et son propre engagement au sein de la structure.
« Mobilisation collective » : qu’il vise à défendre des causes ou faire avancer les droits, Catherine est convaincue par ce mode d’action, dont elle a pu mesurer les fruits, en 1991 et 2017 notamment -pour ne citer que ces deux jalons emblématiques que constituent la scolarisation des enfants sans-papiers et l’opération Papyrus.
« Garde-fou » : Face au repli identitaire, aux discours xénophobes, aux politiques d’exclusion et de discrimination, à la criminalisation des populations migrantes, ou aux politiques néolibérales visant à restreindre nos droits sociaux, le CCSI – tout comme les syndicats et autres acteurs engagés aux côtés des immigré.e.s -, agit comme un « garde-fou », pour défendre les droits acquis, plaider en faveur du vivre ensemble, rappeler les principes de tolérance et de justice sociale. Encore et toujours.
« Résilience »… celle dont font preuve les usagères et usagers que Catherine reçoit dans sa consultation, malgré les adversités rencontrées au quotidien, l’angoisse face à un futur incertain et leur santé fragilisée par la précarité, l’absence d’accès aux soins, et des emplois pénibles. Une résilience qui force le respect, et l’inspire au quotidien.
« Valeurs humaines » : pour Catherine, le CCSI incarne des valeurs essentielles, qui aujourd’hui comme hier doivent être affirmées et réaffirmées. Parmi elles, la solidarité, l’empathie et le respect de la dignité de l’autre, quels que soient son origine et son statut légal. Ces valeurs humaines, Catherine dit les avoir appréciées chez tous·tes les collègues et membres du Comité qu’elle a côtoyé.e.s au CCSI – … et les incarne si bien elle-même !